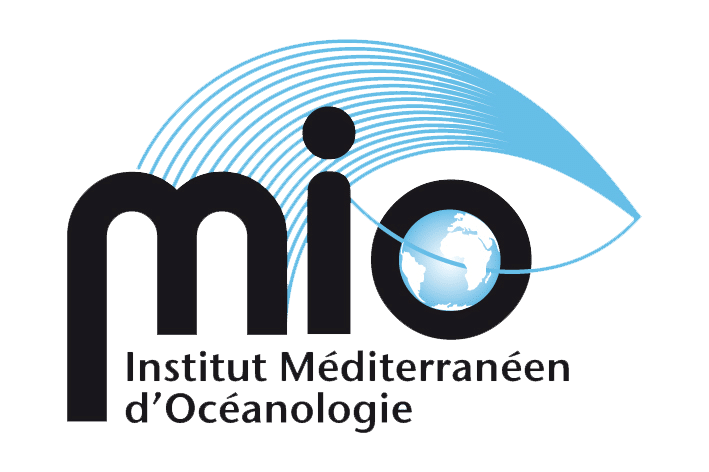Dans l’immensité océane, passé 100 mètres de profondeur, le froid et l’obscurité règnent en maîtres absolus. Les distances sont infinies. Comment communiquer dans ces conditions-là ? Le peuple des abysses, des créatures aux formes étranges défiant l’imaginaire, y parvient au moyen de la bioluminescence : pour se nourrir, repousser un prédateur ou se reproduire. Au large de Toulon, des chercheurs passionnés déploient dans les grands fonds des équipements sophistiqués afin d’observer comment les organismes qui y vivent entrent en relation les uns avec les autres.
« Au sein du monde océanique, loin d’être une exception, la bioluminescence est une stratégie largement répandue, explique Séverine Martini, spécialiste de ce sujet à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie de Marseille (MIO). On a pu voir en effet qu’entre 100 et 4000 mètres de profondeur, près de 75% des espèces de pleine eau de plus d’un centimètre[1] émettent leur propre lumière ». Ce chiffre avoisine 40% s’il s’agit d’organismes vivant sur le fond marin[2]. « La bioluminescence est vraisemblablement un moyen de communication très efficace ». L’océanologue dispose depuis peu d’un nouvel outil de travail : une caméra très sensible à la bioluminescence. Celle-ci équipe « BathyBot », un robot benthique (adapté aux grandes profondeurs) qui, début d’année prochaine, explorera par 2500 mètres de fond les environs d’ORCA. Derrière cet acronyme se cache un important détecteur de neutrinos déployé depuis 2017 au large de Toulon par le Centre de physique des particules de Marseille et appartenant à l’observatoire KM3Net. Biologie marine et physique des particules sont à priori deux champs disciplinaires disjoints. Pas dans le cas présent.
Entre particules cosmiques et organismes marins : une cacophonie lumineuse
Produits un peu partout dans le cosmos, au sein notamment des étoiles comme notre Soleil, les neutrinos sont des particules presque insaisissables, car interagissant extrêmement peu avec la matière. Lorsqu’ils traversent notre planète, certains d’entre eux laissent pour trace de leur passage dans la mer un cône de lumière bleutée : c’est ce que cherchent à détecter les capteurs optiques d’ORCA. « Malheureusement pour les physiciens, la longueur d’onde de ce bleu, autour de 490 nm, correspond à la lumière émise par les organismes bioluminescents, commente la chercheuse du MIO. Un problème qui est apparu lors de la mise en route d’Antares », un détecteur voisin d’ORCA, et qui l’a précédé. Ce premier s’est révélé être, contre toute attente, un observatoire privilégié pour étudier la bioluminescence.
Petit retour en arrière. 2008, Antares est pleinement opérationnel. Immergé par 2400 mètres de fond à 10 milles nautiques (18,5 km) au sud de l’île de Porquerolles, il possède 900 capteurs optiques sensibles au bleu, répartis sur 12 lignes de 400 mètres de long. Le détecteur est relié par un câble électro-optique à l’institut Michel Pacha de la Seyne-sur-Mer, une station de biologie marine rattachée à l’Université de Lyon dès sa fondation en 1890 ; ses données transitent via l’institut jusqu’au Centre de Calcul de l’In2p3* à Villeurbanne, où elles sont stockées. « Les scientifiques exploitant les données d’Antares faisaient face à un bruit de fond trop élevé sur certaines périodes, les photomultiplicateurs chargés de reconstruire les cônes de lumière se déclenchaient en même temps, rendant les signaux alors difficiles à exploiter, raconte Rémi Barbier, maître de conférence à l’Université Claude Bernard Lyon 1. L’hypothèse que la bioluminescence des grands fonds soit responsable de cette cacophonie de signaux a été posée et on m’a demandé d’imaginer une caméra pour observer ce qui se passait. »
D’énigmatiques flashs lumineux
Spécialiste des imageurs sensibles aux photons uniques, en poste alors à l’Institut de physique nucléaire de Lyon (IPNL, baptisé aujourd’hui Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon – Ip2I), Rémi Barbier s’inspire d’une technologie utilisée pour la vision nocturne et conçoit avec son équipe la caméra LuSEApher[3] : un prototype muni d’un capteur sensible à la longueur d’onde de 480 nm et capable de produire un cliché de chaque particule de lumière détectée. « Un signal de 10 photons bioluminescents suffisait à ce que cette caméra se déclenche automatiquement et enregistre une image », détaille le physicien. Une véritable performance technologique. Immergée sur Antares entre novembre 2010 et mars 2012, LuSEApher a enregistré plus d’une cinquantaine de films : pas de photo de méduse ou d’autre organisme posant patiemment devant l’objectif, mais… des halos de photons émis spontanément et dont la source bouge très vite par rapport au courant. Certains adoptent parfois de brusques changements de direction, preuve qu’ils sont produits par autre chose que du plancton ! « Ce travail nous a permis, outre de confirmer la présence de micro et macroorganismes bioluminescents autour du détecteur, de déterminer la signature lumineuse de certains d’entre eux, c’est-à-dire la façon avec laquelle leur lumière décroît avec le temps, complète le chercheur. Un catalogue a ainsi été progressivement constitué. »