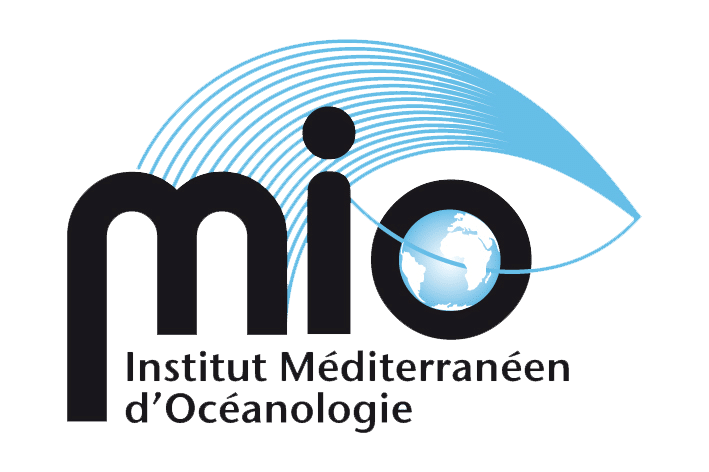La réunion BioSWOT2025 a été l’occasion de présenter les premiers résultats confirmés de la campagne BioSWOT-Med qui s’est déroulée en 2023 et qui a exploré l’influence des tourbillons, des fronts et des filaments océaniques sur la biodiversité marine dans le nord-ouest de la mer Méditerranée.
La réunion de lancement de l’ANR et de la post-campagne BioSWOT (BioSWOT2025) s’est tenue à l’Institut Méditerranéen d’Océanographie (MIO), à Marseille, en France, du 5 au 7 mai 2025. Plus de 45 chercheurs de France, d’Italie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis y ont participé, dont une grande partie de jeunes chercheurs.
L’objectif de BioSWOT2025 était de partager les premiers résultats de l’analyse des données et des échantillons recueillis lors de la campagne BioSWOT-Med. Cette campagne a exploré un régime océanique spécifique, les « échelles fines » (tourbillons, fronts et filaments de 1 à 100 km), censés jouer un rôle primordial sur la vie marine, mais qui sont largement méconnus dans de nombreuses régions océaniques comme la Méditerranée.
« C’est un moment historique pour l’exploration des échelles fines de l’océan, avec une résolution SWOT 10 fois supérieure à ce que nous avions auparavant », a commenté Francesco d’Ovidio (LOCEAN-IPSL), PI du projet ANR BioSWOT et CNES Ocean Lead au sein de l’équipe scientifique SWOT. En effet, pour la première fois dans l’histoire, des données SSH haute définition dérivées des mesures satellitaires SWOT ont été utilisées pour éclairer la stratégie d’échantillonnage adaptatif employée lors d’une campagne océanographique, qui a ciblé les processus physiques et écologiques, de la concentration des nutriments à la distribution des prédateurs supérieurs, en utilisant un large éventail de techniques, allant des plateformes autonomes à la génomique. La comparaison des cartes SWOT et des observations in situ a également été l’occasion de réfléchir à la manière dont la stratégie d’échantillonnage utilisée a fonctionné pour détecter les caractéristiques océaniques à petite échelle.
Plus de 30 conférences ont été données au cours des trois jours de la réunion, et les chercheurs ont discuté des autres collaborations ou outils (par exemple, un cadre de modélisation) qui sont désormais nécessaires pour aller plus loin.
Tenter de démêler les processus à la base de la dynamique physique et des interactions biologiques
L’un des principaux objectifs de recherche du sujet de discussion est de comprendre comment différents processus à petite échelle ont interagi pour produire la dynamique physique et les interactions biologiques observées sur un front et un tourbillon anticyclonique rencontrés lors de la campagne dans le nord de la mer des Baléares. À cet égard, Monique Messié (MBARI) a illustré la méthode de croissance-advection comme une approche de modélisation lagrangienne possible pour étudier la diversité planctonique.
Louise Rousselet (LOCEAN-IPSL) a résumé les informations nécessaires pour éclairer une discussion sur les paysages biophysiques révélés grâce aux données acquises dans BioSWOT-Med, tandis que Magali Lescot (MIO) a illustré le large éventail de résultats obtenus grâce à la génomique marine. En appliquant les techniques omiques (métabarcodage, métagénomique et métatranscriptomique), l’objectif est d’étudier l’impact des échelles fines océaniques sur la diversité planctonique. Et plus particulièrement, d’identifier les espèces présentes, les fonctions biologiques présentes et celles qui étaient actives lors de l’échantillonnage dans les différents types de masses d’eau échantillonnées pendant la campagne. L’étude des techniques omiques est le sujet de l’ANR BioSWOT. Comment exploiter au mieux les informations omiques reçues (pour quelles questions) ?
Forte participation des étudiants et des postdoctorants
L’un des objectifs de la réunion était également de mettre en avant la contribution des étudiants et des jeunes chercheurs aux recherches liées à SWOT. En effet, sur 30 présentations, 10 ont été faites par des étudiants et des chercheurs postdoctoraux. Ludivine Grand et Lou Byrnes, tous deux étudiants en master, ont présenté respectivement des résultats préliminaires sur la distribution à fine échelle de l’ultraplancton et sur une étude lagrangienne de la dynamique à fine échelle.
Parmi les doctorants, Aude Joel (MIO) a présenté les données biogéochimiques sur la circulation océanique à fine échelle et les nutriclines, tandis que Laurina Oms (MIO) a présenté des résultats sur des communautés phytoplanctoniques contrastées le long du front par cytométrie de flux. Camille Cardot a présenté une étude de cas sur l’activité à mésoéchelle, comparant les données dérivées des courants océaniques issues des positions des navires commerciaux et de SWOT. La présentation de Maxime Arnaud a porté sur les vitesses verticales issues de l’acoustique, tandis que celle de Maxime Duranson a porté sur la distribution du zooplancton à fine échelle.
Trois chercheurs postdoctoraux ont présenté leurs résultats. Robin Rolland s’est concentré sur les interactions tourbillon-vent. Théo Garcia a présenté l’approche statistique qu’il a utilisée pour mettre en évidence l’adaptation du phytoplancton aux fronts océaniques ; tandis qu’Alexandre Barboni a comparé les estimations des vitesses géostrophiques et agéostrophiques dérivées de mesures SWOT et ADCP et de simulations numériques. Les résultats d’Emily Wagonner et d’Alba Filella se sont concentrés sur la distribution des esters et polyphosphates organophosphorés.
Résultats inattendus et nouvelles questions de recherche
Anthony Bosse (MIO) a présenté une description à petite échelle de l’anticyclone échantillonné lors de la campagne BioSWOT-Med, tandis que Stéphanie Barillon (MIO) a présenté les résultats obtenus avec l’un des deux seuls systèmes existants à ce jour pour les mesures in situ de la vitesse verticale. Maristella Berta (ISMAR-CNR) a illustré la dynamique agéostrophique reconstituée à partir de l’analyse des bouées dérivantes, tandis que Riccardo Martellucci (OGS) a présenté les résultats préliminaires des analyses biophysiques des flotteurs Argo. La présentation de Jean-Baptiste Roustan s’est concentrée sur les résultats préliminaires de la stratégie à deux navires lors des campagnes WEMSWOT/CSWOT , réalisées juste avant BioSWOT-Med.
Claude Estournel (LEGOS) et Valérie Garnier (IFREMER) a comparé les résultats des modèles Symphonie et Croco avec les données SWOT tandis que Mathilde Cancet a montré comment les données SWOT peuvent aider à comprendre les mécanismes d’intrusions du Courant Nord sur le plateau.
Sandra Nunige (MIO) a brièvement fait le point sur le vaste ensemble de données sur les nutriments qu’elle a contribué à créer, avec des analyses réalisées à bord pendant la croisière (nutriments inorganiques) et en laboratoire. Dominique Lefevre (MIO) a présenté les résultats préliminaires sur la cartographie de surface de la production communautaire nette, tandis que la présentation de Marc Tedetti (MIO) s’est concentré sur la distribution des CDOM et FDOM lors de la campagne BioSWOT-Med. Daniela Banaru (MIO) a parlé de la biomasse du phytoplancton et du zooplancton, du contenu biochimique et des rapports isotopiques stables par fraction de taille.
Parmi les résultats préliminaires présentés lors de la réunion, certains résultats inattendus ont soulevé de nouvelles questions de recherche. Par exemple, les analyses d’Alice della Penna (Université d’Auckland) d’une expérience qu’elle a menée en mésocosmes à bord de L’Atalante, pour estimer l’impact de la migration verticale quotidienne du mésozooplancton dans les communautés de surface de phytoplancton, ont suggéré plusieurs hypothèses concurrentes. La question reste également ouverte sur la manière dont les schémas observés pourraient évoluer dans différentes masses d’eau et sur le rôle de la répartition irrégulière dans l’océan. De son côté, Elvira Pulido (MIO) a également montré des résultats inattendus sur la disponibilité du phosphore et l’absorption de matière organique dissoute par le phytoplancton. L’étude de ces hypothèses nouvelles et concurrentes nécessitera la collaboration de l’équipe interdisciplinaire BioSWOT-Med.
Karine Leblanc (MIO) a montré des images époustouflantes de nano et microplancton (microscopie électronique) et décrit leur distribution lors de la campagne BioSWOT-Med.
Des conditions océaniques contrastées, peut-être représentatives d’autres parties de la mer Méditerranée ?
Les chercheurs se sont également intéressés à discuter de la manière dont les mécanismes physiques et la réponse biologique rencontrés au cours de la croisière sont spécifiques à la mer Méditerranée et lesquels peuvent être typiques de conditions génériquement oligotrophes et modérément énergétiques.
À cet égard, la réunion s’est clôturée par une conférence de Mark Ohman (SCRIPPS), qui a présenté les données collectées au sud de Minorque et à l’intérieur du tourbillon anticyclonique identifié grâce aux images SWOT au nord-est des Baléares par le Zooglider, un instrument robotique autonome unique qui plonge à 400 mètres de profondeur et profile le plancton à l’aide d’une caméra d’imagerie et d’un sonar actif lors de sa remontée dans la colonne d’eau. Les deux régions différaient en termes de température, de salinité, de concentration en chlorophylle et de transparence optique. Parallèlement, les communautés planctoniques différaient également.
Publications et nouvelles étapes
La réunion a débuté le premier jour par la distribution à tous les participants de l’ouvrage « People, science and instruments of the BioSWOT-Med campaign », créé pour donner un aperçu de la richesse scientifique d’une campagne océanographique et préserver la mémoire de la passion et du dévouement des participants au projet BioSWOT-Med. Elle s’est conclue le troisième jour par une discussion générale sur les défis scientifiques à venir et la stratégie à adopter pour raconter « l’histoire d’un front, d’un anticyclone et d’une tempête », les caractéristiques océanographiques et les conditions météorologiques rencontrées lors de la campagne BioSWOT-Med.